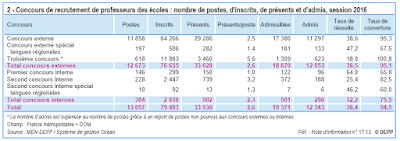À la session 2016, un peu plus de 13 000 postes ont été
ouverts aux concours enseignants du premier degré public (97 % aux concours
externes, 3 % aux concours internes) pour la France métropolitaine et les
départements d’outre-mer, soit + 8 %. Par rapport à la session précédente, le
nombre d’admis aux concours externes poursuit sa progression (+ 4 %). Tandis
que 95 % de ces postes sont pourvus, plus de 600 postes sont restés vacants,
principalement dans les académies de Créteil et de Versailles. L’organisation
pour la seconde fois d’un concours supplémentaire à Créteil a permis de
pourvoir les 500 postes offerts.
Les étudiants issus des Écoles supérieures du professorat et
de l’éducation (ESPÉ) constituent le vivier principal des recrutements externes
: la plupart d’entre eux sont titulaires d’un master métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation. Les lauréats des concours externes ont en
moyenne 28,7 ans. Les candidates y sont largement représentées (85 %).
Au titre de l’année 2016, 13 057 postes sont ouverts au
recrutement de professeurs des écoles avec la répartition suivante : 11 858
postes au concours externe, 197 au concours externe spécial, 618 au troisième
concours, 146 au premier concours interne, 228 au second concours interne et 10
au second concours interne spécial. Ces ouvertures de postes sont en hausse de
8 % par rapport à la session 2015, soit près d’un millier de postes
supplémentaires.
Les lauréats de la session 2016 ont été nommés stagiaires à
la rentrée scolaire de septembre 2016.
Près de 13 000 postes offerts aux concours externes en 2016
À partir de 2012, l’offre de postes aux concours externes
augmente fortement. Elle progresse de 8 % entre les sessions 2015 et 2016. Le
niveau de postes ouverts en 2016 est quatre fois plus élevé qu’en 2011, le plus
bas niveau de cette décennie (figure 1). Il retrouve le niveau de la session
2005.
En 2016, 33 028 candidats présents ont été enregistrés aux
différents concours externes contre 30 735 en 2015, soit une hausse de 7,5 %.
Au cours de ces dernières années, le nombre de candidats augmente moins vite
que le nombre de postes : il a presque doublé depuis 2011. Cependant
l’attractivité du métier d’enseignant dans le premier degré public se maintient
avec 2,6 présents pour un poste depuis 2015.
 Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
95 % des postes pourvus aux concours externes en 2016
Le nombre de candidats inscrits aux concours externes
s’accroît de 16 % par rapport à 2015, mais moins de un candidat inscrit sur
deux (43 % au lieu de 47 % en 2015) se présente à la première épreuve écrite
(figure 2). Ensuite, 57 % des candidats présents sont déclarés admissibles
(contre 60 % en 2015). À l’issue de la phase d’admission, 64 % des candidats
admissibles sont lauréats d’un concours externe (63 % en 2015), portant à plus
de 12 000 le nombre d’admis, soit une augmentation de 4 %, deux fois moins
élevée que celle des postes. Ainsi, 5 % des postes sont restés vacants aux
concours externes contre 1 % en 2015.
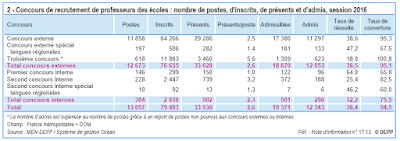 Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Retenter sa chance pour la deuxième année consécutive...
Le nombre de candidats en 2016 est alimenté en partie par
ceux qui avaient échoué aux sessions précédentes. Parmi les 33 028 présents aux
concours externes à la session 2016, 26 % d’entre eux étaient déjà présents à
la session 2015 ; en comparaison, 30 % des présents à la session 2015 l’étaient
déjà à la session 2014 rénovée. Par ailleurs, 9 % des présents en 2016
retentaient leur chance pour la troisième année consécutive (5 % en 2015).
... ou saisir une chance de plus en se présentant au
concours supplémentaire de Créteil
Afin de poursuivre l'amélioration de la situation des écoles
de la Seine-Saint-Denis, 500 postes sont de nouveau offerts au concours
supplémentaire dans l'académie de Créteil en 2016. Cette deuxième édition a
attiré 9 069 inscrits, et 41 % d’entre eux se sont présentés à la première
épreuve d’admissibilité (43 % en 2015). Le nombre de présents diminue de 26 %
en un an. Aussi, le taux de candidature est-il en recul, soit 7,4 candidats
présents pour un poste en 2016 contre 10,1 en 2015. Il reste néanmoins très
supérieur à celui du concours externe classique (1,2) pour cette académie. Tous
les postes ont été pourvus comme en 2015.
Les candidats pouvaient auparavant avoir passé un autre
concours externe. Ainsi, près de 8 % des présents au concours externe
classique, toutes académies confondues, ont choisi de se présenter aussi au
concours supplémentaire de Créteil : 15 % d’entre eux ont été reçus. Parmi les
500 admis au concours supplémentaire de Créteil, plus des trois cinquièmes
étaient présents au concours externe classique et avaient échoué à l’admission.
L’attractivité du métier reste très contrastée selon les
académies et le nombre de postes à pourvoir
À la différence de leurs collègues du secondaire, qui
passent un concours national et peuvent être affectés partout en France, les
enseignants du primaire passent des concours académiques et postulent dans un
département.
Aux concours externes du premier degré, les écarts selon les
académies sont particulièrement élevés quant au nombre de postes ouverts, au
nombre de candidats présents, au taux de réussite observé et au seuil
d’admission (figure 3). En 2016, ce sont les académies de Créteil et de
Versailles qui proposent le plus de postes (plus de 1 700 postes dans chaque,
contre moins de 800 dans les autres académies). Les besoins de recrutements
sont proportionnellement élevés dans les deux académies. Les ouvertures de
postes y représentent 6 % et 5 % des effectifs d’enseignants en activité dans
le premier degré, alors que la moyenne s’établit à 3,8 % : à la rentrée 2016,
les académies enregistrent de fortes hausses d’effectifs d’élèves. Les
académies de Créteil et de Versailles se caractérisent par des taux
d’attractivité faibles, 1,3 candidat présent pour un poste, quand d’autres ont
5 candidats ou plus pour un poste (Clermont-Ferrand, Martinique, La Réunion,
Corse, Guadeloupe). Mais l’offre de postes n’y est pas comparable ; à
Clermont-Ferrand, le nombre de postes est dix-sept fois inférieur à celui de
Créteil. Autrement dit, les académies offrant le plus de postes de professeurs
des écoles ont une moindre attractivité.
Cette « pénurie de candidats » dans certains territoires
académiques se traduit par des postes qui restent vacants. Alors que les postes
offerts aux différents concours externes sont pourvus dans presque toutes les
académies, plus de 400 postes sont restés vacants dans l’académie de Créteil :
24 % des postes n’ont pas trouvé preneur au lieu de 20 % en 2015. Cependant,
les besoins dans cette académie sont comblés en partie par l’organisation du
concours supplémentaire. Au total, avec le concours supplémentaire, 1 821
postes ont été pourvus aux concours externes à Créteil en 2016, soit trois fois
plus qu’en 2011 (555).
Par ailleurs, 200 postes n’ont pas été pourvus dans
l’académie de Versailles, soit 12 % : l’augmentation importante du nombre de
postes ne s’est pas accompagnée d’une même progression du nombre de candidats,
de sorte que l’académie devient déficitaire en 2016, alors que tous les postes
avaient été pourvus en 2015. À Strasbourg, 6 % des postes sont restés vacants,
soit une vingtaine (5 % en 2015).
 Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Les taux de réussite académiques sont toujours très
hétérogènes
Les taux de réussite aux concours externes sont d’autant
plus élevés que les ratios candidats présents/poste sont faibles. Ainsi, les
taux de réussite s’élèvent à 68 % à Versailles et 57 % à Créteil contre 36,5 %
en moyenne nationale en 2016 (37,8 % en 2015) (figure 4). Il est plus difficile
d’être admis à un concours externe dans les académies de Bordeaux ou de Rennes
où les taux de réussite oscillent autour de 25 %, ou de Guadeloupe (13 %).
Par ailleurs, il existe une grande diversité des seuils
d’admission, en fonction des académies, souvent en corrélation avec cette
réussite. En 2016, pour le seul concours externe, les seuils d’admission
varient de 7,4 en Guyane à 13,7 en Corse. Le dernier candidat admis sur liste
principale dans l’académie de Créteil a obtenu 7,5/20, 8,0 dans l’académie de
Versailles contre 13,1 dans les académies de Clermont-Ferrand et de Rennes.
 Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Près de six lauréats sur dix des concours externes sont des
étudiants issus des ESPÉ
Depuis 2014, les concours externes de professeurs des écoles
s’inscrivent dans le contexte d’une évolution importante de la formation
initiale des enseignants, désormais recrutés au niveau master 1 (M1). Ces
concours se situent en milieu de formation (en fin de master 1) et sont
intégrés à un cursus de formation progressive, jusqu’à l’obtention du master 2
(M2). Néanmoins, trois lauréats d’un concours externe 2016 sur dix déclarent
être déjà titulaires d’un diplôme de niveau master 2.
Les étudiants constituent toujours le premier vivier de recrutements
externes d’enseignants du premier degré public : 60 % en 2016, presque tous
issus des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ) (figure
5). Deux lauréats sur dix issus des ESPÉ déclarent posséder un M2 ou être
inscrits en M2 : pour la majorité d’entre eux (62 %), il s’agit d’un M2 «
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) ». 49,3 %
des étudiants en ESPÉ présents ont été admis aux concours externes, quand le
taux de réussite des étudiants hors ESPÉ descend à 27,8 %.
Le métier d’enseignant attire de plus en plus d’autres
profils, mais leurs taux de réussite sont sensiblement inférieurs à ceux des
étudiants en ESPÉ. Les candidats en activité dans les secteurs public ou privé
représentent 17 % des recrutements externes (15 % en 2015). Les demandeurs
d’emploi constituent toujours un renfort important (11 %), une représentation
comparable à celle de la session précédente.
L’âge des admis aux concours externes est lié à leur
parcours antérieur (figure 5). Les étudiants sont en moyenne plus jeunes : 25,8
ans pour les étudiants issus des ESPÉ. Les lauréats en activité dans les
secteurs public ou privé ont neuf ans de plus, les demandeurs d’emploi sept
ans. Globalement, l’âge moyen passe de 28,2 ans en 2015 à 28,7 ans en 2016. Les
femmes représentent 85 % des admis. Depuis 2004, le taux a fluctué entre 83 %
et 87 %. Les nouvelles recrues de la session 2016 continuent de renforcer la
féminisation de la population enseignante du premier degré public, qui
s’établit à 83 % en décembre 2015.
 Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Près de 400 postes ouverts aux concours internes
Au premier concours interne, le nombre de postes (146) reste
proche de celui de 2015 (137), mais la baisse tendancielle de la dernière
décennie reflète celle du vivier des instituteurs : ils étaient 83 000
titulaires en 2004 contre 4 588 en 2016.
Aux seconds concours internes, l’offre de postes augmente
pour la deuxième année consécutive (+ 24 %, soit 238 postes). Le nombre de
candidats présents progresse plus vite (+ 29 %).
Aucun de ces deux types de concours ne fait le plein ;
globalement, 75,5 % des postes ouverts ont été pourvus.
Par ailleurs, la session 2016 est la quatrième de l’examen
professionnalisé réservé de professeurs des écoles institué par la loi
Sauvadet. Le vivier des candidats se réduit et en conséquence le nombre de
candidats. 3 candidats ont été admis pour 23 postes proposés (respectivement 14
et 40 en 2015).