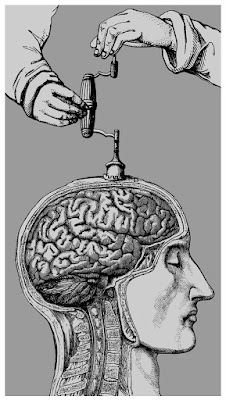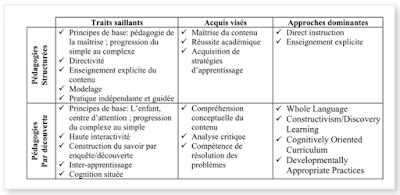De petits changements pour de GRANDES réussites
Renouveler la pédagogie avec un enseignement explicite et structuré, instructionniste, vraiment moderne et efficace. Faire connaître et reconnaître le nouveau courant de la Pédagogie Explicite.
Translate
vendredi 29 avril 2016
mercredi 27 avril 2016
Formation initiale : le formatage idéologique constructiviste
Dans un article intitulé “Critique de l’idéal constructiviste dans l’enseignement de la lecture”, Janine Reichstadt
évoque une étude réalisée par Marc Daguzon et Roland Goigoux sur “L’influence de la prescription adressée aux professeurs des écoles en formation initiale : la construction d’un idéal pédagogique” (Actualité de la Recherche en Éducation
et en Formation, Strasbourg, 2007) qui a démontré formellement ce que tout
le monde savait déjà : c’est l’idéal pédagogique constructiviste qui
inspire en profondeur l’ensemble de la formation initiale (aussi bien que continue) des professeurs des écoles.
Voici ce qu’écrit Janine Reichstadt :
Marc Daguzon et Roland Goigoux partent des questions : « Comment s’apprend le métier de professeur des écoles ? Et comment les débutants construisent-ils leurs premières compétences et leur identité professionnelle ? Plus précisément, comment conçoivent-ils leur action pédagogique en réponse aux injonctions et aux attentes de l’institution éducative telles qu’ils les perçoivent et les interprètent ? » Les réponses à ces questions ont été élaborées auprès de professeurs stagiaires (PE2) en cours de formation professionnelle en IUFM.
Les résultats de cette recherche montrent la portée de la formation en IUFM qui parvient à produire chez les futurs maîtres un modèle pédagogique affirmé et pleinement partagé qui se constitue en idéal pédagogique en mesure de devenir la matrice même des apprentissages relatifs au métier, encore à venir. Unanimement, les stagiaires sont convaincus de la valeur du modèle constructiviste devant les guider afin de faire vivre une classe « active où les élèves construisent leurs savoirs ». Dans cette optique, comme le précisent les chercheurs, « La qualité du travail du maître dépend moins de l’exactitude de ses explications en classe que de la pertinence de ses choix préalables des situations didactiques », des situations qui doivent permettre aux élèves de construire leurs savoirs en recourant à des phases préalables d’émergence des représentations. Ces situations sont « majoritairement des situations de résolution de problèmes, suivies par des débats entre élèves et par des phases d’institutionnalisation des savoirs. »
Dans un passage intitulé « Une doxa puérocentriste », nous pouvons lire les postures pédagogiques suivantes que les stagiaires reprennent à leur compte :
- « Les élèves doivent être actifs. » Il s’agit de faire en sorte que les élèves entrent dans une action visible, qu’ils participent.
- « Les élèves doivent être motivés. » Il convient de leur proposer des tâches attractives et ludiques.
- « Les élèves doivent prendre la parole. » Mettre en place des situations d’échanges, de travail de groupe, de débats, est censé permettre aux apprentissages de se développer par interactions entre pairs.
Cette doxa qui caractérise l’homogénéité de la posture des stagiaires rencontre un principe lourd de conséquences qui fait de l’enseignant un médiateur, et non pas quelqu’un dont le rôle est fondamentalement d’enseigner, c’est-à-dire de permettre aux élèves de comprendre, de s’approprier des connaissances clairement identifiées. « Il [le médiateur] doit éviter d’exposer les savoirs de manière trop magistrale ou de montrer des procédures, un peu comme si les explications du professeur étaient suspectées de gêner les apprentissages des élèves. » Cela confirme la présentation de la qualité du maitre qui doit reléguer l’exactitude de ses explications au second plan, à cela près qu’elle s’ajuste au glissement sémantique qui passe du maître au médiateur.
Cette recherche montre également que l’année de préparation du concours (PRCE) a commencé à présenter aux futurs maîtres de façon très efficace les représentations convergentes des principes pédagogiques qu’ils partagent et qu’ils ont bien l’intention de mettre en œuvre lorsqu’ils auront la charge d’une classe. « Ils pensent qu’ils ont bien compris ce qu’on attend d’eux et ils jugent cette attente légitime (…) même s’ils ont le sentiment de « toujours entendre la même chose » car, si les contenus didactiques sont différents, les orientations et le vocabulaire des formateurs sont similaires. » Cette similarité des orientations et du vocabulaire des formateurs identifiée par les stagiaires montre bien, nous disent les chercheurs, la cohérence des modèles pédagogiques à l’œuvre dans la formation, une cohérence qui repose fondamentalement sur les principes du socioconstructivisme.
Inutile alors de se demander d’où vient le naufrage de l’École
française…
dimanche 17 avril 2016
Livre : Le maître-camarade et la pédagogie libertaire (Jakob Robert Schmid)
Écrit (en Suisse) en
1936, ce livre rend compte de la mise en œuvre d’une pédagogie libertaire, dans
quatre écoles de Hambourg, sous la république de Weimar. Précisons tout de
suite que, sur les quatre communautés scolaires créées en 1919, une seule a
disparu à cause de l’avènement du national-socialisme en 1933. Deux avaient
déjà renoncé à l’expérience dès 1925. Et la quatrième exista jusqu’en 1930.
Le préfacier, Boris
Fraenkel, met en comparaison cette tentative pédagogique avec celle de A.S. Neill à Summerhill : « Hambourg
dépasse encore, si cela est concevable, Summerhill, car il s’agissait
d’expériences non pas dans un milieu scolaire privé payant, mais d’écoles
communales du tout-venant, à Hambourg et ensuite dans quelques autres villes de
l’Allemagne de Weimar » (p 7). Cet élément est en effet très
important : la démarche pédagogique des maîtres-camarades de Hambourg
s’adressait à des élèves du public, donc à tout le monde (contrairement à
Summerhill).
Ce même préfacier nous
met aussi en garde au sujet de l’auteur, qu’il décrit comme un adversaire de
cette expérience. Pour ma part, compte tenu du sujet traité, je le considère
plutôt comme un observateur relativement bienveillant, en tout cas objectif. Si
Jakob Robert Schmid exprime des réserves, c’est qu’il a des raisons
parfaitement fondées et argumentées.
« La création des écoles d’essai de Hambourg
remonte (…) à la fin de l’année 1918, les trois premières furent ouvertes au
printemps 1919, c’est-à-dire au lendemain de la révolution socialiste allemande »
(p 65). Les maîtres-camarades ont profité des circonstances qui ont suivi la
défaite allemande de 1918. En effet, la république de Weimar, si elle n’a pas
fait une grande réforme éducative, a permis nombre d’expériences et d’essais
pédagogiques aussi bien dans l’enseignement public que privé. « Ces écoles se sont fait libérer, le jour de
leur ouverture, des obligations que prévoit une législation scolaire ;
elles ont été exemptées de réaliser tel et tel programme d’après telle ou telle
méthode et aux heures d’un horaire fixe. (…) C’est ce qui permit à ces instituteurs
de travailler en toute liberté » (p 53).
« Les
communautés scolaires ont été fondées d’abord à Hambourg, au lendemain de la
guerre. Il s’agit de quatre écoles publiques comptant chacune plus de 600
élèves. (…) Leur particularité consistait essentiellement en ce qu’aucune “méthode”
n’y était pratiquée ! Au début, les instituteurs n’eurent guère d’autre
programme que celui de profiter à fond de leur liberté d’expérimentation, de
travailler en reniant les anciennes traditions et tout cet appareil de règles et
d’organisation qui trace en général exactement la voie au travail de
l’instituteur d’État. » (p 24)
Les maîtres-camarades de
Hambourg trouvèrent leur inspiration pédagogique chez Jean-Jacques Rousseau, des
néo-rousseauistes (Ellen Key et Ludwig Gurlitt), dans l’enseignement
naturel de Berthold Otto, dans la libre communauté scolaire de Gustave Wyneken,
dans le mouvement de la jeunesse (Jugendbewegung).
L’axiome de départ - commun à tous - est que l’enfant est naturellement
curieux, travailleur, vif, ouvert aux autres, coopératif.
La pédagogie Vom Kinde aus des maîtres-camarades est
une pédagogie révolutionnaire. « On
trouve en effet à ses origines la négation passionnée de toute opinion reçue en
pédagogie. En tant que principe didactique, elle s’en prend au programme, à
l’horaire et non seulement à toutes les méthodes classiques et modernes, mais à
la notion de “méthode” elle-même. Elle ne veut admettre comme principe
directeur que le libre épanouissement de l’intérêt et de la spontanéité de
l’enfant. Dans le domaine de l’éducation morale et sociale, elle fait la
guerre à toute idée d’un but en éducation ; par-là, elle refuse à
l’éducation toute mission préparatoire. Elle rejette, par conséquent, toute
contrainte, voire toute influence directe en éducation et les remplace par la
conduite spontanée de l’enfant dans la communauté » (p 192-193).
Sur le plan pédagogique,
les maîtres-camarades de Hambourg ne revendiquent donc aucune méthode
d’enseignement. Étaient rejetées aussi bien les pratiques traditionnelles que
les pratiques des autres pédagogies alternatives. De fait, on évitait toute
démarche préétablie au profit de la liberté absolue dont jouissaient les
élèves. « Ce qui frappe en premier
lieu (…), c’est la liberté presque absolue dont jouissent les enfants (…). Elle
se manifeste dans tous les domaines de la vie scolaire » (p 28). Donc
on ne trouvera dans ce livre aucune indication sur une pratique pédagogique
quelconque. Tout au plus, nous apprenons que « tout l’enseignement était fondé sur le travail collectif, sur le
travail en groupe ; tout effort individuel (recherches particulières,
petites conférences, etc.) avait trait à la question qui occupait le groupe
entier, était entrepris dans l’intérêt du travail en commun et était jugé de ce
point de vue » (p 37). Comment était évalué ce travail ? « Un trait de caractère propre à cet
enseignement réside aussi dans le fait que les communautés scolaires ne
délivraient pas de bulletins et ne connaissaient pas les examens. (…) Des
rapports ou certificats distinguant les enfants en “bons” et “mauvais” élèves
eussent été défavorables au sentiment de communauté qui devait les unir »
(p 37). Une tâche de moins à accomplir pour les maîtres ! Mais alors que
faisaient-ils ? « Quoique nos
pédagogues aient accordé aux enfants une liberté presque sans borne et transmis
à la communauté leurs fonctions disciplinaires, ils ne restaient quand même pas
du tout passifs. (…) Grâce au fait que le maître ne restait justement pas en
dehors de la communauté, mais qu’il en faisait partie. La communauté, c’était
en effet l’ensemble des élèves et des maîtres » (p 39). Le travail des
enseignants consiste donc à être avant tout un membre de la communauté scolaire…
« L’effort principal des maîtres consistait à
faire naître et à développer chez les enfants les notions de coopération et de
solidarité et à encourager la création parmi eux d’une communauté capable de
s’imposer » (p 36).
Un des maîtres-camarades affirmait :
« L’école n’est pas un moyen, c’est
un but ; pas seulement une transition mais bien un accomplissement »
(p 52). L’école ne s’intéresse donc qu’au présent des élèves et non à leur
avenir, contrairement à ce qui est habituellement son rôle. Pour un autre
maître-camarade « la tâche de
l’école, c’est d’offrir à l’enfant un lieu où il pourra être enfant, jeune et
joyeux, sans tenir compte de buts à atteindre, mais en développant en lui un
sens de responsabilité envers les êtres humains parmi lesquels il vit »
(p 52-53). Selon cette conception particulière, « l’école ne doit donc plus être une préparation à la vie, mais la vie
elle-même » (p 53). Peu importe ce que deviendront les élèves une fois
parvenus à leur vie d’adultes.
« La nouvelle pédagogie dont nous parlons
avait rayé de son vocabulaire cette notion de but. Les mêmes principes qui
amenaient nos pédagogues à ne plus vouloir reconnaître les buts didactiques
leur faisaient rejeter de même toute notion de fin dans l’éducation morale et
sociale » (p 54). Voilà donc une rupture par rapport aux autres pédagogues
alternatifs, les maîtres-camarades ne voulaient pas préparer l’Homme
nouveau des lendemains qui chantent.
On le voit, la pédagogie
libertaire ne craint pas de s’opposer aux autres pédagogies “progressistes”,
dont les procédés maintiennent « le
concept “éducation” dans l’acception de ce terme qui désigne un procédé actif
d’influence exercée sur l’enfant » (p 103) Pour les pédagogues de Hambourg,
« l’éducation n’était plus une
méthode, mais la vie elle-même, elle n’était plus un procédé d’intervention,
mais la reconnaissance du développement et de la libre croissance de l’enfant.
(…) Voilà ce qui donne à la pédagogie libertaire son caractère révolutionnaire
et radicalement nouveau par rapport aux autres tentatives d’éducation nouvelle »
(p 103). Certains qui se réclament aujourd’hui de la pédagogie libertaire
feraient bien de s’en souvenir. Cela leur éviterait de se rallier aux démarches
pédagogiques préconisées par des communistes, comme Freinet ou d’autres. Après
ce qu’ont fait subir les communistes aux anarchistes (en Ukraine ou en
Espagne), on ne se serait pas attendu à ce que les seconds prissent aujourd'hui leur
inspiration chez les premiers !
Toutefois si, pour les
maîtres-camarades, l’école doit se suffire à elle-même comme but, il n’en va
pas de même sur le plan matériel. « On
pourrait s’attendre à ce que ces pédagogues aient tiré la dernière conséquence
de leur postulat en proclamant (…) l’indépendance matérielle de l’école (…).
L’école aurait alors eu la charge de se suffire à elle-même, grâce au travail
productif des maîtres et des enfants. (…) Nos pédagogues de Hambourg, par
contre, n’ont pas voulu de l’école de production. Il leur répugnait de faire du
travail des enfants un facteur économique » (p 53). Il ne faut quand
même pas exagérer…
On l’a vu, les
maîtres-camarades étaient des rousseauistes convaincus. Ainsi, « la pédagogie ainsi qu’ils la comprenaient ne
doit reconnaître d’autre point de départ ni d’autre but que la nature de
l’enfant : elle ne doit se soumettre à aucune règle ou prescription qu’aux
lois de la spontanéité de l’enfant » (p 56). C’est l’enfant-roi avant
l’heure : « L’enfant est devenu
ainsi (…) la mesure de toute chose dans cette éducation ; c’était le seul
point stable qui subsistât après l’abolition de tous les facteurs déterminants
que reconnaît la pédagogie classique » (p 57). Et l’auteur de
conclure : « Il y a, au fond de
ce postulat, une foi absolue dans la bonté de la nature » (p 58). Les
vicissitudes de l’expérience des communautés scolaires de Hambourg se
chargeront de les ramener amèrement à la triste réalité.
Le dogme fondamental de
la pédagogie libertaire, c’est la liberté de l’enfant. Ainsi, ce sont les
élèves qui décident de leurs apprentissages : « L’enseignement lui-même était basé entièrement sur le libre intérêt et
la spontanéité des enfants. (…) Aucune contrainte d’apprendre quoi que ce soit
n’était exercée sur les enfants, aucun effort ne leur était demandé, qui ne fût
spontané et volontaire. Les cas où les élèves de deuxième et même de troisième
année ne savaient ni lire ni écrire n’étaient pas rares. Ils restaient
ignorants des choses qu’ils n’avaient pas encore le désir d’apprendre »
(p 29). Dès lors, « partout où autrefois
l’initiative du maître avait indiqué la direction, où son intervention avait
assuré l’ordre nécessaire au travail, où ses paroles et ses démarches avaient
influé sur le développement moral des enfants, bref, dans tous les domaines de
l’éducation scolaire, les enfants, dans la nouvelle école, sont apparemment
abandonnés à eux-mêmes et se chargent de prendre des décisions comme bon leur
semble. L’effacement du maître (…), tel est le résultat direct de la
liberté accordée aux enfants » (p 33).
« Dans l’enseignement toutes les initiatives
partaient des élèves. C’étaient eux qui désiraient aborder un sujet, eux qui
proposaient qu’on l’abandonnât. Le travail n’était jamais imposé par les
maîtres (…). Un instituteur dit par exemple qu’au début, lorsque les enfants
lui demandaient du travail, il refusait nettement de leur en donner, parce
qu’il voulait qu’ils le trouvassent eux-mêmes » (p 33).
Voyons ce que donne cette
liberté accordée aux élèves. Un visiteur raconte : « Durant une leçon, il observa que trois
élèves jouaient tranquillement aux cartes pendant que le maître parlait à la
classe, et celui-ci, bien qu’il s’en rendît compte, n’intervint pas »
(p 33).
Les maîtres-camarades
comptaient beaucoup sur la spontanéité et la créativité des enfants, moteur de
toutes les activités : « L’idéal
de l’élève tranquille et attentif fait place à celui de l’élève plein de
mouvement et d’initiative. La qualité première de l’élève d’hier – la capacité
de reproduire consciencieusement ce que le maître et le manuel lui présentaient
– a perdu de sa valeur ; on lui préfère une autre qualité : la
spontanéité productive et créatrice de l’élève d’aujourd’hui ou de demain »
(p 75). En oubliant que la créativité n’existe pas ex nihilo, qu’elle est le fruit de connaissances et d’habiletés acquises
antérieurement. Voilà une erreur ontologique qui condamne à l’échec toutes les pratiques
pédagogiques basées sur la “créativité” spontanée des élèves.
Une autre erreur
constructiviste classique consiste à abolir chez l’élève tout effort pour
s’appuyer uniquement sur le seul intérêt qu’il va ressentir … ou pas : « De là l’importance que la nouvelle
conception attribue au besoin, à l’intérêt, notions qu’elle a substituées à
l’effort qui était le grand principe de l’enseignement réceptif et reproductif »
(p 75). Or, chacun sait que sans effort, il n’y a pas de réussites. Le coup de bol pour parvenir à ses fins s'avère, dans les faits, une solution très hasardeuse.
Bien entendu, en
pédagogie libertaire, il n’y a plus de sanction : « Dès le premier jour, [les maîtres]
annoncèrent à leurs élèves qu’il n’existait plus de punition ni d’autre
sanction, qu’il ne serait pas question d’interdictions ou d’un règlement
quelconque qui pourrait les gêner dans l’usage de leur pleine liberté. Le
premier résultat fut un chaos indescriptible » (p 32). Mais cela
n’entraîne pas un changement de pratique : « Des abus se produisaient cependant constamment, les maîtres ne le
cachent point dans leurs rapports. Mais ils tiennent toujours à souligner
qu’ils se sont abstenus quand même de toute intervention directe et coercitive »
(p 33).
Dans toutes les
pédagogies “nouvelles”, l’enseignant ne veut pas assumer la gestion de classe.
Il la délègue à une sorte de soviet des élèves appelé Conseil de coopérative ou
Assemblée générale. Hambourg ne fait bien sûr pas exception à cette
règle : « Les écoliers
apprirent ainsi qu’ils ne pouvaient pas compter davantage sur les maîtres que
sur eux-mêmes, que les maîtres ne songeaient nullement à imposer l’ordre, mais
qu’ils l’attendaient des enfants eux-mêmes. Les élèves n’avaient donc qu’à s’en
charger, et ils le firent. Des assemblées générales furent convoquées, où les
enfants se reprochèrent mutuellement le désordre et l’anarchie, mais où ils
tâchèrent aussi d’y remédier. On se promit de veiller à un meilleur ordre et
d’exercer un contrôle mutuel ; dans quelques écoles, on désigna un comité
d’élèves qui fut muni de droits policiers et qui fut rendu responsable de la
discipline à l’école » (p 34). Dès lors, c’est le soviet des élèves
qui s’occupe de la discipline en se transformant en Tribunal du peuple lorsque
le besoin s’en fait sentir : « En
classe, de même, ce furent les élèves qui se chargèrent d’assurer des
conditions favorables au travail. Les travailleurs avaient commencé à se
plaindre du dérangement perpétuel de la part des “chahuteurs” et des “flemmards”,
ils se mirent à réagir en se battant avec eux et en les éloignant ; ainsi
on parvint peu à peu à un certain calme pendant la leçon » (p 34).
Faire régler les comptes entre élèves, est-ce une vraiment solution raisonnable
pour un enseignant digne de ce nom ?
J’ai toutefois trouvé une
citation d’un maître-camarade qui mérite d’être rapportée : « C’est une absurdité que de voir dans une
école un petit État, organisé d’après des principes démocratiques ! À quoi
bon ces tribunaux d’enfants ? Ils élèvent des murs au lieu de les
abolir. Quand il est question, parmi mes garçons et mes filles, d’amener une
décision par un vote de majorité – c’est un signe pour moi que quelque chose va
de travers » (p 101). Encore un élément de rupture de la pédagogie
libertaire par rapport aux autres pédagogies alternatives d’inspiration “progressiste”.
À quoi pouvait donc
servir le maître dans ces conditions ? « De même dans les assemblées générales, les maîtres ne prétendaient à
aucun droit exceptionnel pour leur voix et pour leur avis. Ils étaient là,
discutaient, émettaient et défendaient leur opinion et se soumettaient aux
décisions générales au même titre que n’importe quel élève » (p 40).
Avec un bémol toutefois, il fallait que les décisions de l’Assemblée générale
n’aillent pas à l’encontre des présupposés pédagogiques des maîtres (par
exemple, si l’AG demandait au maître de jouer son vrai rôle !).
Les soviets d’élèves,
tant prisés dans les pédagogies “alternatives”, sont des lieux où l’égalité
entre adultes et enfants est totalement fictive. Ce qui ouvre la porte à toutes
les manipulations par personne ayant de fait une autorité (même si elle
proclame le contraire). L’auteur pose une bonne question : « Nous pouvons nous demander si cette égalité
et cette camaraderie entre les maîtres et leurs élèves n’excluaient pas une
influence concrète et proprement pédagogique des éducateurs sur les enfants,
influence dépassant celle du “vrai camarade” » (p 40). Il n’est pas
surprenant que les adultes soient très vite devenus des camarades en chef. Mais,
sous couvert d’Assemblée générale, le simulacre de démocratie était sauf.
« Un groupe de maîtres peut se mettre d’accord
pour ne faire usage d’aucune contrainte, pour ne jamais recourir à aucune
mesure coercitive ; on peut convenir même de vivre avec les écoliers dans
une égalité et une intimité de camarades ; mais l’influence personnelle et
les rapports vivants dépendent à un tel point des individualités et des
impondérables du caractère qu’il faut compter avec des différences
considérables dans l’application de ces décisions » (p 41). C’est
l’ascendant naturel que prend l’adulte sur l’enfant, même si l’adulte s’en
défend. « Bien qu’il fît à tous
égards partie de la communauté, le maître n’en était pas membre au même titre
que n’importe quel élève. Il restait supérieur aux autres, non en droit, mais
en fait » (p 42). L’auteur note également : « Outre la supériorité intellectuelle qui se
manifestait évidemment avant tout dans l’enseignement, la vie de la communauté
scolaire était fortement imprégnée aussi de la supériorité morale et de
l’influence directrice des maîtres » (p 42).
Dans les assemblées
générales, « combien souvent
était-ce l’opinion d’un ou de plusieurs maîtres qui l’emportait dans la
discussion ! » (p 42). Donc, « le juste rapport pédagogique que les efforts originaux de libération
absolue et l’effacement voulu du maître avaient paru supprimer s’était ainsi
reconstitué dans une certaine mesure » (p 43). Et c’est bien ce qui me
gêne beaucoup dans ces pédagogies qui proclament respecter les enfants et qui
les manipulent de fait sournoisement dans ces Conseils ou Assemblées où la voix des adultes pèse plus lourd.
Dans les communautés
scolaires de Hambourg, les maîtres-camarades décidèrent dans un premier temps
qu’il n’y aurait plus de classes, plus de divisions en fonction de l’âge, comme
dans les écoles traditionnelles. « À
cette “classe” rigide, les pédagogues de Hambourg avaient substitué le “groupe”
élastique librement composé autour d’un maître. Les enfants choisissaient
eux-mêmes le groupe auquel ils voulaient appartenir et la possibilité leur
était donnée de changer de groupe. Toutefois, les maîtres furent bientôt
obligés de rendre le changement de groupe plus difficile pour parer à une
fluctuation permanente qui menaçait de paralyser tout travail sérieux et suivi »
(p 29). L’idéal, pour ces communautés scolaires, aurait été l’internat (comme à
Summerhill) : « Cette vie en
commun réunissant les éducateurs et leurs élèves eût été sans doute plus
intense encore si ces écoles avaient été
des internats.» (p 46). Mais cela n’a pas été le cas.
Comme les élèves
pouvaient faire ce qu’ils voulaient, certains ne venaient plus à l’école. Une
fois encore, ce fut le soviet des élèves qui se chargea de remettre un peu
d’ordre : « De plus, les élèves
luttèrent contre les absences fréquentes qui avaient des répercussions très
désagréables sur la classe, car chacun avait sa fonction particulière dans le
travail collectif. Ils allèrent s’enquérir personnellement de la raison des
absences et solliciter les parents d’envoyer leurs enfants régulièrement à
l’école. On vit souvent aussi des grands ramener à l’école, avec plus ou moins
de douceur, les amateurs de l’école buissonnière » (p 34-35).
La promiscuité voulue
entre maîtres et élèves comporte également un grand danger que Jakob Robert
Schmid évoque pudiquement. Un des maîtres-camarades, M.K. Zeidler disait :
« Nous savons qu’éduquer un être
humain veut dire : l’aimer. Et notre grand désir, la condition
indispensable pour que notre travail porte des fruits, c’est d’être aimés de
nos élèves » (p 47). Or, « cette
affection n’est pas purement spirituelle, mais […] il faut reconnaître qu’elle
a sa base dans un sentiment physique et même qu’elle a ses racines dernières
dans l’instinct sexuel » (p 47). L’amour des maîtres pour les enfants
devint dans certains cas très douteux : « Ces efforts visibles pour vivre sur pied d’égalité et en grande
intimité avec les enfants, ne nous portent-ils pas à croire que l’amour du
maître-camarade pour ses élèves est sensiblement différent de l’affection que
témoignent en général les pédagogues à leurs pupilles ? » (p
178). Plus grave encore, « enfin
nous avons pu constater nous-mêmes chez des éducateurs que nous connaissions et
qui avaient réalisé la camaraderie intégrale avec leurs élèves, que des
sentiments analogues ont été à la base de leur attitude. Nous pouvons donc
affirmer que cette disposition affective fait souvent partie intégrante de
l’attitude du maître-camarade, qu’elle est même dans beaucoup de cas le mobile
psychique, subconscient peut-être, qui y détermine un éducateur » (p
179). Cela aboutit, pour l’un d’entre eux, Wyneken, à une condamnation en 1921
par un tribunal allemand à un an de prison pour délits homosexuels commis
contre deux de ses élèves. Ce qui n’est pas cher payé…
Reste à aborder le
chapitre des résultats obtenus par cette tentative pédagogique.
« Si l’on peut admettre qu’en éducation la
valeur d’un essai doit être jugé à l’aide des résultats visibles obtenus (…),
notre critique est en droit de partir du fait que la tentative de Hambourg
s’est terminée par un échec indéniable » (p 164). On ne peut être plus
clair…
Le grand principe de la
liberté absolue de l’enfant n’a pas résisté longtemps : « Tout d’abord, peu de temps après l’ouverture
des écoles, [les maîtres] durent apprendre qu’on ne peut pas vivre dans une
école avec des enfants sans obliger ceux-ci à observer quelques prescriptions
et défenses » (p 165). On a assisté très vite au retour du respect des
horaires, des récréations communes, des classes, de l’autorité des maîtres, des
sanctions (et même des gifles !).
Plusieurs facteurs
expliquent cet échec :
- les circonstances
extérieures : dans l’immédiat après-guerre, il y a une grande misère
matérielle et morale, l’inflation, tout cela compliqué par une atmosphère de
guerre civile ;
- les autorités scolaires
de Hambourg : la totale liberté laissée aux communautés scolaires prend
fin en 1925, désormais leur sont prescrits les mêmes buts qu’aux écoles
publiques ordinaires ;
- les parents
d’élèves : dont la désapprobation se voit au nombre décroissant des
enfants envoyés dans les communautés scolaires ; une mère dit (en 1925)
« que les enfants n’apprenaient
rien, que leur éducation morale était complètement négligée, que les enfants
sortant des communautés scolaires avaient de grandes difficultés à s’adapter à
la vie pratique et professionnelle » (p 168-169) ; et même un maître
dit (en 1923) : « Il faut
avouer que les parents qui laissent leur enfant chez nous font preuve de peu
d’intérêt en ce qui concerne son avenir » (p 169) ;
- les maîtres
eux-mêmes : certains étaient attirés par l’absence de contrôle de leur
travail, d’autres étaient meilleurs dans les discours que dans l’action,
d’autres étaient trop individualistes pour entreprendre un travail d’équipe, enfin
le radicalisme des plus jeunes se heurtait à la modération des plus âgés ;
- les enfants
aussi : c’étaient des enfants de prolétaires vivant souvent dans la
pauvreté et même la misère ; « les
écoles d’essai recevaient fréquemment des enfants qui, en raison de leur
médiocrité intellectuelle ou à cause de quelque défaut de caractère, avaient
échoué dans les écoles publiques » (p 170) ; « souvent on voit un maître se plaindre que
parmi ses écoliers il y aurait des enfants dont la place était dans une classe
pour arriérés » (p 170).
Les maîtres-camarades
« avaient attendu (…) que les
enfants répondent à la suppression de toute contrainte dans le travail par un
élan et un intérêt spontanés et soutenus, par une discipline de travail
volontaire, assurant de bons résultats. Ils durent s’apercevoir bientôt qu’ils
avaient été trop optimistes » (p 170). « Ce qui décevait surtout les maîtres, c’était (…) l’attitude des enfants
à l’égard de leur travail. (…) On voyait les enfants se livrer à un
dilettantisme excessif dans toutes les branches, même dans le chant »
(p 171).
« On attendait en vain la naissance de
l’effort qui seul aurait assuré, de l’avis même de nos pédagogues, des
résultats positifs et constants » (p 171). « L’impression dominante est que les enfants, jouissant de leur liberté,
s’occupaient d’un sujet aussi longtemps qu’ils en tiraient quelque plaisir, et
qu’ils l’abandonnaient au moment où le travail aurait demandé un effort réel et
de la persévérance » (p 171).
« On avait cru tout d’abord que la classe ou “le
groupe”, donc la communauté des enfants, rendrait superflue toute intervention
de la part du maître, que cette communauté réagirait non seulement contre le
désordre, mais qu’elle se chargerait dans une large mesure de toutes les fonctions
éducatives nécessaires. (…) Mais il semble bien que nos pédagogues ont
surestimé le sentiment social existant de prime abord chez leurs enfants »
(p 172).
Un maître-camarade avoue :
« Partout où l’on se laissa guider
par une confiance sans borne dans le tact des enfants, dans leur force de
volonté, dans leur persévérance, dans la sûreté de leur instinct et dans la
tendance des individus à former une communauté, partout le résultat fut qu’au
lieu des communautés qu’on désirait obtenir, on vit se former des bandes
indisciplinées » (p 173).
« Les réactions des enfants étaient souvent
telles que le maître perdait courage et patience. Les abus et l’ingratitude
rendirent quelquefois impossible aux maîtres l’égalité d’humeur et la
cordialité » (p 173). « Fréquemment
les maîtres récoltèrent en réponse à leur bienveillance des grossièretés et des
impertinences déconcertantes » (p 174).
« La conclusion qui s’impose à nous, c’est que
toute tentative analogue subirait le même insuccès » (p 181). Cela a
été depuis démontré à de multiples reprises.
« Il semble plutôt que les réactions négatives
des enfants se seraient montrées partout, parce qu’elles étaient dues à la
pédagogie Vom Kinde aus et en particulier à quelques erreurs psychologiques
capitales qui faussent cette conception » (p 181). « À la place de l’enrichissement prodigieux du
travail scolaire que l’on attendait de la libération de la spontanéité
enfantine, un appauvrissement déplorable surgit dans toutes les branches. Il
ressort de cette constatation que le travail des enfants déçut les maîtres non
seulement au point de vue des résultats tangibles, mais aussi par son contenu
imaginatif. Car c’est sans doute sur l’imagination des enfants qu’on avait
compté en espérant cet enrichissement créateur » (p 182).
« Que les enfants de Hambourg n’aient pas été
capables de se discipliner eux-mêmes en toute liberté, sans aucune prescription
ni défense, cela tenait, croyons-nous, moins à leurs caractères qu’au fait
qu’ils n’étaient bien, après tout, que des enfants ! Car le nouveau “règlement”
des communautés scolaires faisait appel à une discipline intérieure et à un
sentiment de responsabilité qu’on ne peut demander légitimement que d’adultes,
et parmi eux seulement de personnalités d’un niveau spirituel et moral assez
élevé » (p 183-184).
Le réquisitoire est sans appel,
et se passe de commentaires.
Laissons le dernier mot à
un des maîtres-camarades, Lottig, qui écrivit en 1921 : « Je frémis souvent en pensant à l’époque où
il se produira un réveil chez nos élèves et où ils nous feront le
reproche : pourquoi ne m’as-tu pas, en son temps, remis quelque chose qui
puisse vraiment me servir ? » (p 196).
Et c’est bien le reproche
que je fais aux anarchistes d’aujourd’hui qui promeuvent toujours des démarches
pédagogiques désastreuses qui ont toujours échoué partout. Quand ils ne se
réclament pas de Freinet ou d’autres pédagogues communistes (donc autoritaires),
ce qui devrait les révulser. Les prolétaires méritent que leurs enfants
bénéficient d’une instruction de qualité, les mettant en situation de réussite et
leur permettant d’acquérir des connaissances solides et des habiletés
nombreuses. Cela seules les pédagogies efficaces peuvent le permettre et c’est
donc par elles qu’il faut passer si l’on veut des adultes éclairés, à l’esprit
critique aiguisé, ne s’en laissant pas compter facilement par les beaux
discours, œuvrant à améliorer leur sort et celui de l’Humanité.
Que les anarchistes se
décident enfin à laisser les pédagogies inefficaces aux sociétés sans avenir et
aux mondes voués à disparaître.
______________________________________
Jakob
Robert Schmid
François Maspero (coll. Textes à l'appui), 217 p
1976
jeudi 14 avril 2016
Des sciences de l’éducation si peu scientifiques
Source : Gynger
Franck Ramus
L’université Paris
Descartes a organisé le samedi 19 mars une nouvelle édition des
« controverses de Descartes », en partenariat avec les éditions
Nathan et la fondation SNCF. Le thème: « l’école, entre révélation et
élévation ». L’une des conférences, consacrée à l’apprentissage de la
lecture, a été l’occasion pour Franck Ramus, spécialiste du développement
cognitif de l’enfant, de souligner le profond retard de la France en matière
d’éducation fondée sur des preuves.
L’éducation et la
pédagogie constituent des terrains de batailles intenses, l’actualité nous le
prouve presque tous les jours. On voit s’écharper les constructivistes, les
pédagogistes, les modernistes, les tenants de Piaget, les adeptes de Montessori
et les thuriféraires de Freinet. Comme l’écrivait Jacques Julliard dans un
article du Monde en mai 2015, l’éducation nationale relève d’une névrose
française. Surtout, les débats restent théoriques, conceptuels, presque
hors-sol, comme si en matière d’éducation rien n’avait jamais été démontré,
comme si les sciences cognitives n’avaient pas connu un incroyable essor ces 30
dernières années, multipliant les études et recherches expérimentales. Cette
déconnexion entre l’univers de l’éducation et celui de la recherche a fait
l’objet d’une édifiante présentation par Franck Ramus, spécialiste du
développement cognitif de l’enfant et de ses troubles, directeur de recherche
au CNRS, lors des « Controverses de Descartes » organisées ce samedi
19 mars par l’Université Paris Descartes.
Il était invité à
débattre avec Roland Goigoux, enseignant chercheur, professeur des universités
à Clermont-Ferrand. Ce dernier vient de mener une considérable étude intitulée LireEcrireCP, sur les pratiques d’enseignement en CP
dont les résultats intermédiaires ont été récemment publiés et rappelés lors de
la conférence de consensus sur la lecture organisée à la mi-mars. La recherche
menée par Roland Goigoux relève d’une approche dite « écologique »
dans la mesure où il s’agissait d’observer et non d’intervenir sur les
pratiques des enseignants. L’objectif : mesurer l’effet de ce qui se passe
en classe sur les performances des élèves. Selon les premiers résultats, les
performances initiales des élèves expliquent pour 53% leurs résultats à l’issue
du CP. Autrement dit, le poids de ce qui s’est passé avant le CP, dans la
famille, à l’école maternelle, est très lourd.
En revanche, les
caractéristiques socio-démographiques des élèves pèsent moins (5%) que la
caractéristique de la classe (8,1%) sur leurs résultats. Roland Goigoux
note que les différences sont minimes entre les classes et assure que le choix
du manuel (et donc de la méthode) a peu d’impact sur les performances des
élèves. « Ca rend très modeste sur le poids des pédagogies, sur des
méthodes qui résoudraient définitivement les problèmes de la lecture »,
en conclut-il. Roland Goigoux insiste beaucoup : les enseignants du
CP enseignent le code et le déchiffrage de façon systématique. Une façon de
dire qu’il n’existe pas de tenants purs et durs de la méthode globale. En
revanche, les maîtres de CP investissent peu dans la compréhension. Le CP
constituerait une parenthèse, très axée sur le code et laissant de côté le
travail de compréhension à partir de textes lus par l’enseignant. Aux
enseignants il préconise : « Il faut distinguer les textes que
vous proposez aux élèves, à découvrir en autonomie, et à côté les nourrir en
textes que vous leur lisez et qui viennent culturellement et linguistiquement
stimuler leur intelligence. Les maîtres ne s’autorisent pas à dissocier leurs
supports sous prétexte d’articuler en permanence le code et le sens. Ils
essaient de faire tout tout le temps. »
Franck Ramus prend
ensuite la parole. Et commence par saluer le travail de Roland Goigoux avec un
art consommé du compliment à double tranchant. « Enfin ! Enfin une
étude de grande ampleur méthodologiquement rigoureuse qui essaie de poser les
vraies questions. Ce genre d’approche est exceptionnel en France. Des études
comme celles-ci il en faudrait des dizaines chaque année». Il note que la
méthodologie adoptée par l’enquête LireEcrireCP n’est pas la plus prisée du
milieu scientifique mais qu’elle demeure néanmoins « appropriée ». Ce
qui pose un souci à Franck Ramus, en revanche, c’est le calendrier mis en œuvre
pour communiquer autour de cette étude. « Il reste à faire évaluer les résultats et à publier au niveau
international. C’est comme ça que le travail est expertisé. Ce processus est
propre à la recherche scientifique, il est essentiel. Alors on peut commencer à
parler des résultats mais pas avant. Ici, on a fait le contraire. On a
communiqué avec une conférence de presse. Peut-être un jour écrira-t-on un
article pour une revue internationale. »
Le chercheur considère
que cette procédure est déontologiquement contestable, même si le risque de conclusions
biaisées apparaît comme modéré dans la mesure où les résultats semblent
rejoindre ceux précédemment obtenus dans la littérature internationale.
Pour Franck Ramus, même
si les données intermédiaires de l’étude pilotée par Roland Goigoux confirment
ce que l’on savait déjà, ces travaux n’en étaient pas moins utiles. La plupart
des études précédentes étaient en langue anglaise, il est donc important de
pouvoir en confirmer les conclusions avec des études en langue française.
Notamment parce que c’est une bonne façon de faire enfin accepter le consensus
international sur cette question par la communauté éducative française.
Car sur ce sujet comme
sur d’autres, les débats sont d’autant plus houleux qu’ils sont déconnectés des
données de la recherche. « Fin 2005, raconte Franck Ramus, quand
Gilles de Robien a dit qu’il fallait imposer la méthode syllabique, en réponse,
tous les syndicats d’enseignants et beaucoup d’enseignants-chercheurs sont
montés au créneau. C’est là qu’avec des collègues nous avons voulu introduire
des données factuelles. On a rappelé ce que montrait la recherche : la
nécessité d’un enseignement systématique, explicite, précoce du déchiffrage et
d’une initiation à la morphologie et à la syntaxe. Il faut voir comment nous
avons été reçus. C’est qui ces chercheurs ? Qu’est-ce qu’ils connaissent
de la classe ? On n’était pas perçus comme légitimes. On ne peut pas
dire qu’il n’y a pas eu d’études scientifiques sur le sujet. Pourquoi faut-il
autant de temps pour que ces résultats soient acceptés en France ?» Le
chercheur cite le National Reading Panel aux USA, revue de littérature qui a
sélectionné 38 études sur des critères méthodologiques. En plus de cette vaste
revue, il rappelle que plus de 2000 études concernant plus de 550.000 enfants
ont été menées sur l’apprentissage de la lecture.
Au-delà de
l’apprentissage de la lecture, Franck Ramus explique en quoi consiste
l’éducation fondée sur des preuves, un concept assez exotique en France. « Pour faire progresser
l’enseignement il ne suffit pas de se baser sur une philosophie ou un auteur,
de faire des observations en classe, d’en dégager des intuitions et de produire
du discours savant. Il faut formuler des hypothèses précises, réfutables, sur
l’effet de pratiques pédagogiques sur les apprentissages, se donner les moyens
de les tester rigoureusement en collectant des données factuelles (par
l’expérimentation, essais randomisés contrôlés, par l’observation systématique,
quantifiée et contrôlée), publier les résultats dans des revues scientifiques
internationales, faire des méta-analyses pour synthétiser les résultats. »
Le chercheur ne prend pas
de gants. « En France
l’éducation n’est pas l’affaire de scientifiques mais de gourous. Ils n’ont pas
lu la recherche scientifique sur le sujet et ils influencent les politiques. On
ne peut pas dire qu’on ne sait rien, encore faut-il aller chercher la
connaissance là où elle est. » Il évoque le livre de John Hattie (Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement)
, véritable somme sur l’apprentissage qui recense 800 méta-analyses, soit 52637
études basées sur plus de 100 millions d’élèves dans plusieurs dizaines de
pays. Parmi les 425 études portant sur
les relations grapho-phonémiques, combien ont été réalisées en France ?
Aucune. « On ne fait rien de toutes ces données en France, on n’a
même pas idée que ça existe, assène Franck Ramus à un auditoire
essentiellement composé d’enseignants. John Hattie a plein de choses à nous apprendre mais il n’est même
pas traduit en France. Pourquoi ? Parce que les gourous inondent les
librairies. Il y a tellement de connaissances au niveau international, c’est un
crime de les cacher aux enseignants. »
Franck Ramus plaide pour
une révolution culturelle dans l’éducation à tous les niveaux, pour la
diffusion d’une culture de l’évaluation et de la recherche scientifique, celle
qui prévaut en matière de santé. « On
ne peut pas se satisfaire de notre ignorance franco-française. Il faut arrêter
de dire aux enseignants « Piaget a dit ceci, Vygotsky a dit cela »,
il faut les impliquer dans la démarche scientifique. » Notamment pour que leurs élèves puissent
« apprendre à apprendre ». Car dire à un élève
« apprends ta poésie » ne suffit pas. Encore faut-il lui expliquer
qu’il existe des méthodes plus efficaces que d’autres pour apprendre un texte.
Décidé à ne pas prendre son auditoire dans le sens du poil, Franck Ramus
ajoute : « Parmi les données les plus utiles qu’on peut avoir pour
comprendre comment fonctionne le système éducatif d’un pays il y a le résultat
des évaluations nationales. C’est une mine d’or pour les chercheurs. Mais les
enseignants y sont très opposés ».
Le chercheur propose
plusieurs sources pour se familiariser avec cette « éducation basée sur
des preuves » : « Make It Stick » de Henry Roediger, « Pourquoi les enfants n’aiment pas l’ école » de Daniel Willingham,
et « The everyday parenting toolkit » de Alan Kazdin.
Au sujet de ce dernier, qui fait le bilan de tous les acquis de la psychologie
comportementale, Franck Ramus estime qu’il devrait être « traduit par
le Ministère de l’Éducation Nationale et envoyé à tous les parents ».
Le souci, avec ces ouvrages, c’est qu’ils sont en effet pour la plupart en
anglais et non traduits.
Derrière le déroulé
précis, les références scientifiques, le ton parfois sarcastique, on sent bien
l’irritation et la consternation du chercheur. Il faut dire qu’un peu plus tôt,
sur l’estrade, le linguiste Alain Bentolila a affirmé sans qu’aucune
contradiction ne lui soit apportée que « les difficultés mécaniques des enfants dyslexiques sont la conséquence
des difficultés de la relation à l’autre ». De quoi en effet
légèrement agacer un spécialiste de la cognition et de ses troubles.
mardi 5 avril 2016
L’invraisemblable imbroglio des sciences de l’éducation
Source : De Orbis Terrae Concordia
par Kevin Queral
Voilà maintenant plusieurs décennies que l’on voit
épisodiquement resurgir le même débat autour de l’école française : la mise en scène vous en est
certainement familière.
D’un côté, ceux que nos médias ont pris l’habitude d’appeler républicains,
partisans d’un retour aux anciennes méthodes d’apprentissages, de l’autorité du
maître, de la méritocratie. De l’autre, ceux que nous entendons couramment
baptisés du nom de pédagogistes : ce seraient quant à eux la
communauté des chercheurs en sciences de l’éducation et leurs adeptes :
constructivisme, bienveillance, enfant au centre des apprentissages,
cognitivisme, compétences, et autres pédagogies par projet seraient le fruit de
leurs travaux universitaires.
Les premiers accusent ainsi les seconds d’un effondrement de
notre système d’instruction. Les seconds arguent de la scientificité de leur
démarche, évoquent la massification scolaire et promeuvent un enseignement
centré sur l’élève en
guise de panacée.
C’est en somme Alain Finkielkraut face à Philippe Meirieu.
Ainsi posés les termes du débat, il n’est guère surprenant
que la joute oratoire ne couronne jamais véritablement de champion. Car en
l’espèce, si cet habituel numéro de duettistes est souvent pittoresque, il est
toutefois pourvu d’un vice de taille, celui d’escamoter habilement et
durablement une tierce appréciation : celle précisément des chercheurs en
science de l’éducation catégoriquement opposés aux vues de leurs confrères
pédagogistes !
Accroire au monolithisme doctrinal des sciences de
l’éducation, voilà l’écueil où viennent se fracasser invariablement nos
opinions. Essayons alors de nous éloigner des récifs…
Un schisme méconnu du grand public et des
enseignants.
L’univers de la recherche en science de l’éducation, tout
comme celui d’un grand nombre de disciplines universitaires au demeurant, n’est
bien évidemment pas d’un seul tenant. Et s’il ne saurait être question ici de
dresser un inventaire exhaustif de ses différentes écoles, il est toutefois
possible d’inscrire toutes ses tendances au sein de deux grandes catégories.
Dans un récent article, le professeur de l’Université Laval, Clermont Gauthier,
les définit d’ailleurs ainsi :
- D’un côté, les approches centrées sur l’enseignement (basic
skills models ou modèles académiques), orientées vers un enseignement
systématique des apprentissages de base (lecture, écriture, mathématiques).
- De l’autre, les approches centrées sur l’élève, appelées
modèles cognitivistes (cognitive skills models) ou modèles affectifs (affective
skills models). Les premiers centrés sur le respect du niveau de l’enfant
et de son style d’apprentissage ; les seconds sur le respect du rythme de
chacun, de ses besoins et de ses intérêts.
Cliquer pour agrandir
Tableau
synthétique des deux grandes écoles de pédagogie,
L’antagonisme des deux postulats est manifeste. Bien sûr,
les républicains seraient naturellement mieux disposés à défendre
la première famille théorique. Mais pour de curieuses raisons, la plupart
d’entre eux semblent ignorer jusqu’à son existence même, n’en reprenant jamais
ni les études ni la philosophie générale dans leurs appels à la restauration
d’un ordre pédagogique ancien.
C’est ainsi qu’invariablement, si l’on dit en France « sciences
de l’éducation », personne n’imagine découvrir autre chose que les travaux de
la seconde école.
Que disent les tenants des pédagogies structurées
?
C’est peu dire que cette approche souffre dans les médias
autant qu’au sein de l’éducation nationale d’un déficit de publicité
considérable. C’est pourquoi il nous semble important d’en présenter rapidement
les préconisations majeures et les conclusions générales.
Cela peut paraître stupide, mais il fallait d’abord vérifier
que l’enseignant avait réellement une influence sur la progression de ses
élèves. Si tel n’était pas le cas, il était en effet de peu d’importance de
chercher à déterminer de quelle manière il devait conduire ses cours.
C’est ainsi que différentes études statistiques ont été
conduites dans plusieurs états au cours du temps. Retenons ici celle dirigée
par William Sanders en 1996 à
la demande du ministère de l’éducation du Tennesse (TVAAS) et dont les
conclusions démontrent que l’enseignant a bel et bien un effet sur ses élèves
et particulièrement sur les plus faibles d’entre eux.
Il semblerait malheureusement que même madame Florence
Robine n’ait pas connaissance de ces recherches lorsqu’elle affirme que l’enfant n’a pas besoin de maître pour apprendre.
Cliquer pour agrandir
Cet apport de l’enseignant est appelé en toute inélégance
“effet-maître”. Ajoutons immédiatement qu’il est passablement ignoré ou minoré
par les pédagogistes français, comme le déploraient déjà en 2012 Véronique Bedin et Dominique Broussal dans
un excellent article.
La question de la pédagogie employée par le professeur est
donc absolument centrale.
Or, contrairement aux pédagogies centrées sur l’élève, les
approches centrées sur l’enseignement impliquent une plus grande activité du
professeur.
Voici donc la manière dont un cours devrait être dispensé
selon les enseignements dits structurés, et plus particulièrement selon la
méthode Direct Instruction (voir ces liens pour
davantage de précisions) :
1– La
mise en situation : l’enseignant présente clairement l’objet de la
leçon, en explicite les attendus et s’assure de la maîtrise des connaissances
préalables par sa classe.
2– La
leçon (3 étapes) :
- Le “modelage”.
L’enseignant exécute devant ses élèves et à voix haute toutes les
opérations intellectuelles nécessaires à la compréhension. Il présente les
informations en petites unités, allant de la plus simple à la plus
complexe.
- La
pratique dirigée : l’enseignant ne laisse pas sa classe en autonomie. Il
vérifie la compréhension de sa classe en lui proposant des tâches
semblables à celles qu’il a présentées lors de la phase de modelage. Par
un jeu des questions-réponses guidé par le maître, les élèves ont une
rétroaction immédiate sur leur compréhension. Cette pratique est prolongée
le temps nécessaire.
- La pratique autonome : les élèves sont laissés en autonomie sur des tâches toujours similaires et en grand nombre.
3- L’objectivation : l’enseignant synthétise
et réexplicite ce qui doit être su et compris.
Comment a-t-on choisi entre ces deux
pédagogies ?
À l’heure de la réforme du collège 2016, des parcours spiralaires, des îlots curriculaires, des
savoir-être soclés, des EPI le Cid-Flamenco-Guernica-Paëlla, et de
l’abandon des contenus pour les compétences, en un mot, de l’extravagant
triomphe des pédagogies par découverte, il nous faut certainement conclure à la
supériorité du second modèle sur le premier.
Comment en effet imaginer aujourd’hui l’absence complète de
dispositifs issus des préconisations des pédagogies structurées, voire leur
unanime condamnation, si ce n’est par la démonstration empirique de leur
inefficience ?
Les non spécialistes seront certainement surpris d’apprendre
qu’aucune étude comparative de grande ampleur n’a jamais été menée en Europe à
ce sujet, principalement pour des raisons budgétaires.
Mais, en 1967, le gouvernement fédéral américain, afin
d’optimiser ses dépenses d’éducation, décida du lancement d’un programme
comparatif sans précédent : le projet Follow Through.
Ainsi, de 1968 à 1977, une vingtaine de pédagogies furent
évaluées auprès de 352 000 élèves et de nombreuses données furent collectées.
Il s’agit là de la seule étude statistique de grande ampleur et prolongée dans
le temps dont nous disposons encore de nos jours. De plus, le gouvernement
américain finança jusqu’à 1995 différents statisticiens afin d’affiner et de
réexaminer les modèles utilisés.
Voici les résultats de cette étude :
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Ces chiffres ont de quoi laisser songeurs : les pratiques
centrées sur l’enseignement obtiennent en tous points de meilleurs résultats
que les pratiques centrées sur l’élève !
La plus grande surprise ne réside pas tellement dans le fait
que les élèves démontrent de plus grandes capacités dans la maîtrise des basic
skills(mathématiques, lecture, orthographe, langue), mais bien dans le fait
que ceux qui ont reçu un enseignement structuré possèdent également une
meilleure estime d’eux-mêmes et de plus grandes facultés cognitives.
La défaite des tenants des modèles cognitifs et affectifs
est ici totale. La polémique pouvait commencer.
Les vaincus dénoncèrent la déficience du modèle statistique
utilisé, mais de manière surprenante toutes les contre-expertises (House et Glass 1979, Bereiter 1981, Becker et
Carnine, 1981, Lipsey et Wilson, 1993, Watkins 1996, Crahay, 2000, Borman,
2002) ne firent que confirmer et parfois amplifier les premières conclusions.
Ces analyses postérieures permirent aussi d’exhiber quelques
phénomènes méconnus : réduire par exemple un effectif ne serait efficace que
quand la pédagogie l’est aussi ! Dit sommairement, mieux vaudrait un
enseignement structuré à trente, qu’un groupe autonome de cinq élèves engagés
dans une pédagogie par projet !
La dispute autour de ces données et de leurs conséquences
n’a depuis pas cessé outre-Atlantique. Les circonstances notamment qui ont
amené le gouvernement américain à ne pas tenir compte de ces résultats et à
continuer de financer également tout type de pédagogie fait encore aujourd’hui
débat (voir The Follow Through Evaluation).
En France, il semblerait que le déni soit parfait. On feint
d’ignorer cette étude et quand certains chercheurs essaient de la mettre en
avant, les arguments pédagogistes se résument souvent à l’attaque ad hominem,
ou au dédain.
Ont-ils une meilleure étude à citer ? Non. On peut aussi
lire couramment sous leur plume qu’il est impossible de mener un étude
statistique rigoureuse à si grande échelle : c’est particulièrement arrangeant
lorsque l’on en a aucune à proposer… et permet aussi plaisamment de continuer à
deviser du sexe des anges sans craindre qu’advienne un jour une forme de
mesure, pourtant parfaitement nécessaire.
Le contenu des débats entre Serge Pouts-Lajus, Mario Richard et Steeve Bissonnette est
à ce sujet assez édifiant.
Mais plus encore, se pose désormais la question de la
scientificité d’un certain nombre de recherches pédagogiques. Quelles études
statistiques les soutiennent ? Les a-t-on soumises à l’épreuve du même crible
que les résultats de Follow Through ?
Le rôle des affects et des sympathies idéologiques jouent
définitivement un trop grand rôle et dessert lourdement l’avancée de recherches
opératoires.
En définitive, le choix entre les deux catégories de
pédagogie n’a aucunement été fait en suivant des critères scientifiques
indubitables.
Que faire désormais ?
De nombreux parents et enseignants contemplent, interdits,
les recommandations des nouveaux programmes de cycle 3 et 4 : logique
curriculaire (plus que contestée), approches par compétences (promues par l’OCDE et tout aussi contestées),
travail en îlots, interdisciplinarité contrainte, disparition de l’étude
rigoureuse de la langue, étude thématique de l’Histoire, pédagogie par projet
systématique, silence du professeur changé en animateur…
Il en va de ce regard certainement comme de celui de l’abbé
cistercien découvrant en son temps l’hérésie cathare, oscillant quelque part
entre incrédulité et aversion. Pour sûr cependant, il croit distinguer le
visage de la folie grimaçante !
Il serait certes plaisant, au point où nous sommes rendus,
de suivre le mot d’Amaury lors
du sac de Béziers (« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. »),
ce serait là une joyeuse réplique aux humiliations et renoncements imposés
depuis des décennies par un certain catéchisme pédagogiste devenu dogmatique et
autoritaire.
Mais nous manquerions alors notre but, et nous dirions que
l’étude scientifique de l’enseignement est définitivement une faillite.
Rouvrons plutôt de manière fracassante les débats clos sans
avoir été tranchés, demandons la rationalité aux chercheurs, exigeons des
mesures et des protocoles valides et disqualifions enfin ceux qui refuseraient
de s’y soumettre.
Inscription à :
Articles (Atom)