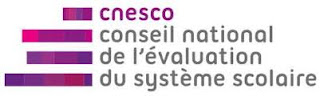Entretien avec Jean-Louis
Auduc
Les garçons échouent davantage que les filles scolairement. Mais au
final n'est-ce pas eux que l'on retrouve dans les meilleures filières ?
Aujourd'hui on voit bien qu'il y a une
mutation dans l'orientation. C'est ce que montrent les travaux de Françoise
Vouillot pour l'INETOP. Elle dit que c'est une erreur d'avoir fait campagne sur
l'orientation des filles alors que ce sont les garçons qui fuient certaines
filières parmi les plus rentables, comme la médecine, la magistrature ou la
pharmacie. Cela crée une situation de fracture sexuée des métiers que l'on n'a
jamais connue.
Aujourd'hui en série S,
on a globalement une parité garçons filles. Mais c'est l'option qui
différencie. Le débat n'est plus entre lettres et sciences mais dans les
sciences, entre les métiers qui s'occupent de l'humain et les métiers de
techniciens. Par exemple en médecine, les filles représentaient 40 % des
doctorants alors qu'elles sont les deux tiers aujourd'hui. On a des mutations
de métiers et ce qui m'inquiète, c'est qu’on ne s'en inquiète pas !
En même temps on observe
une moindre rentabilité du diplôme chez les filles. À diplôme égal, elles
choisissent davantage l'emploi salarié, pour des raisons familiales, là où les
garçons vont choisir davantage des professions libérales. Avec ces choix,
l'écart de revenu augmente.
C'est un phénomène général ou français ?
C'est un phénomène
français. Je le montre bien à partir de PISA 2012 où la France a gommé une
partie du rapport de l'OCDE qui disait que la faiblesse de la France c'est la
triple fracture sociale, ethnique et de genre. On est le pays qui a le plus
augmenté la fracture sexuée depuis 2000, de 29 points à 44. Il y a une cécité
française sur cette question. J'ai écrit ce livre parce qu'on refuse de mettre
cette différence à jour alors qu'elle conduit à une situation d'échec pour les
garçons. On continue de parler d'élèves asexués à propos du décrochage ou de la
lecture alors que les difficultés concernent les garçons. Le garçon est
confronté à des femmes à l'école. L'identificateur garçon est absent ce qui
laisse les garçons en proie à de mauvais bergers. En ne traitant pas cette
question, on les conforte. C'est ce que montre le rapport Trajectoires de l'INED publié en janvier qui montre bien les
différences garçons-filles.
Si on regarde les causes, c'est lié à la féminisation de l'enseignement
?
Non. C'est lié au fait
qu'aujourd'hui il y a une différence d'attitude fille-garçon dans les familles
traditionnelles avec le garçon petit-roi qui va refuser à l'école la correction
alors que la fille l'accepte. Ça a été étudié dans les pays scandinaves. Ils
travaillent cela à l'entrée dans l'école avec les garçons pour leur expliquer
que se tromper fait partie du processus scolaire. Le fait en France de
considérer l'erreur comme un péché pénalise les garçons sur les premières
années.
Il y a un autre moment
difficile pour les garçons au moment de l'entrée au collège. Entre 10 et 13 ans
le garçon ne sait pas s'il est un enfant ou un ado. On n’a aucune gestion de la
sortie de l'enfance et ça pèse sur les garçons. Les violences scolaires sont un
rite initiatique comme le dit Sylvie Ayral. Il y a un vrai problème d'indifférenciation
des sexes et de confusion des âges. Cela génère une crise d'identité chez les
garçons. La solution serait d'avoir un rite solennel de sortie de
l'enfance. Je le propose à l'entrée en 5e.
L'identification c'est le
troisième problème. Si ça ne concernait que les professeures, ça ne serait pas
grave. Mais tous les métiers en rapport avec le quotidien se sont féminisés. On
a des identificateurs pour les filles (médecin, pharmacienne, copsy, etc.) et pas
pour les garçons. Il faudrait donc pour certains métiers avoir des actions
spécifiques pour les garçons.
Vous proposez de différencier la pédagogie. C'est-à-dire ?
Aujourd'hui il y a 98 %
de garçons dans les structures de remédiation. Il faut faire en sorte que,
comme dans les pays scandinaves aux moments clés, il y ait une légère
différenciation pédagogique. Il faut qu'on ait 2 ou 3 heures par semaine de
soutien scolaire préventif. C'est ce qui se fait en Suède ou en Écosse. Par
exemple des concours lecture à 8 ans pour leur montrer que la lecture n'est pas
réservée aux filles. Un rapport de l'Inspection générale en 2013 a mis en cause
cette indifférenciation au genre. Il dit qu'on n'a pas pensé la mixité.
Si on veut défendre la
mixité il faut se demander si une ou deux heures où on sépare garçons et filles
ne seraient pas nécessaires pour l'apprentissage de la lecture ou l'orientation
par exemple. Je suis pour une mixité pensée et gérée, en s'appuyant sur les
expériences de certains pays. En Suède par exemple on a un concours spécifique
pour qu'il y ait au moins un homme dans chaque structure préélémentaire.
Dans les pays anglosaxons se répand l'idée d'avoir des écoles pour
filles et des écoles pour garçons. Qu'en pensez-vous ?
C'est la dérive que je
veux éviter. Les études disent que ça ne résout pas les problèmes mais conforte
les stéréotypes.
Comment expliquer la cécité française ?
On n'a pas pensé la
mixité. On a eu une vision économique. Et puis l'indifférenciation allait mieux
avec la vulgate républicaine. Toute une série de questions qui renvoient à
l'environnement social et culturel de l'enfant n'a pas été prise en compte à
l'école. Et ça continue. On continue à dire qu'il y a 140 000 décrocheurs alors
que ce sont aux trois quarts des garçons. De même, on n'aborde pas la question
pour l'apprentissage de la lecture. Je fais connaître toutes les recherches qui
existent et qui se heurtent à la cécité.
C'est une question que vous avez soulevé au ministère ?
Oui. J'avais demandé en
2011 qu'il y ait dans la circulaire de rentrée la demande de bilans présentés
par genre dans les établissements scolaires. Les établissements qui l'ont fait
ont montré des choses très riches. Par exemple, dans un établissement il y a 8
filles pour 1 garçon dans les emprunts au CDI. Aujourd'hui le texte existe
toujours mais il est tombé dans l'oubli. Et puis la question de l'ABCD de
l'égalité a contribué à enterrer cette question.
Propos recueillis par François Jarraud